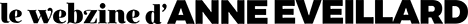Elle travaille seule, mais sur un plateau urbain du IXe arrondissement de Paris, où se côtoient une pléiade de métiers. Son atelier est un peu planqué, mais elle a l’œil rivé sur la vie, la ville. Les photos postées sur les réseaux sociaux sont l’une de ses sources d’inspiration. Ses outils : des pinceaux. Elle les trempe dans des mélanges « maison ». Sa matière première : « C’était d’abord du papier, puis sur les conseils d’un ami, j’ai opté pour le drap », raconte Juliette Lemontey. Parce que cette artiste privilégie le travail « à partir de l’existant ». « Or, un drap a une vie, une couleur, une histoire, sur lesquelles je vais laisser la trace d’un ressenti. » Avant de peindre, elle attaque d’abord au fusain, « dont le trait est proche de la gravure ». La gravure et son aspect définitif du trait : c’était sa spécialité aux Beaux-Arts de Valence. A l’époque, elle ne montrait rien de son travail perso. « J’avais 18 ans, je ne me sentais pas assez mûre. Je dessinais, je gravais, mais seulement quand j’étais seule. » Une fois diplômée, elle retourne à Grenoble, où elle a grandi. Elle fréquente alors les puces, les brocantes, les antiquaires, ces stands et boutiques où le passé se superpose, puis se recompose dans le présent. C’est là qu’elle fouine, chine et déniche ses premiers draps. Des tissus qui ont vécu et qu’elle tend sur des châssis, comme pour leur offrir une nouvelle existence. Quant à leur couleur ternie, délavée, flinguée, elle vient s’ajouter à la palette de l’artiste. Telle une teinte en plus.
Elle travaille seule, mais sur un plateau urbain du IXe arrondissement de Paris, où se côtoient une pléiade de métiers. Son atelier est un peu planqué, mais elle a l’œil rivé sur la vie, la ville. Les photos postées sur les réseaux sociaux sont l’une de ses sources d’inspiration. Ses outils : des pinceaux. Elle les trempe dans des mélanges « maison ». Sa matière première : « C’était d’abord du papier, puis sur les conseils d’un ami, j’ai opté pour le drap », raconte Juliette Lemontey. Parce que cette artiste privilégie le travail « à partir de l’existant ». « Or, un drap a une vie, une couleur, une histoire, sur lesquelles je vais laisser la trace d’un ressenti. » Avant de peindre, elle attaque d’abord au fusain, « dont le trait est proche de la gravure ». La gravure et son aspect définitif du trait : c’était sa spécialité aux Beaux-Arts de Valence. A l’époque, elle ne montrait rien de son travail perso. « J’avais 18 ans, je ne me sentais pas assez mûre. Je dessinais, je gravais, mais seulement quand j’étais seule. » Une fois diplômée, elle retourne à Grenoble, où elle a grandi. Elle fréquente alors les puces, les brocantes, les antiquaires, ces stands et boutiques où le passé se superpose, puis se recompose dans le présent. C’est là qu’elle fouine, chine et déniche ses premiers draps. Des tissus qui ont vécu et qu’elle tend sur des châssis, comme pour leur offrir une nouvelle existence. Quant à leur couleur ternie, délavée, flinguée, elle vient s’ajouter à la palette de l’artiste. Telle une teinte en plus.
Ses toiles n’ont pas de cadre

© Celeste Leeuwenburg
« Je travaille en musique. » Mais Juliette Lemontey n’a pas de playlist préétablie. Elle s’en remet aux choix aléatoires d’une radio, d’une plateforme de streaming : l’art et le hasard, deux mots qui vont très bien ensemble. Quant à la particularité de ses personnages, « ils sont silencieux ». Autrement dit : ils n’ont pas de visage. Un blanc, un vide, pour susciter l’imaginaire de l’observateur. Pour le questionner aussi : se projette-t-il dans l’espace vierge ? Se sent-il regardé à son tour ? Présence ou absence de l’autre ? Tout est possible et l’artiste tient à ce que chacun s’approprie son travail comme bon lui semble. Elle refuse les interprétations uniques, les étiquettes, l’étroitesse d’esprit. C’est sans doute pour ça que ses toiles n’ont pas de cadre. Mais pas seulement. Ils n’en ont pas car, libres de tout carcan, les draps sont plus faciles à retourner pour être peints à nouveau. Entre jeu et double « je », cette pratique est récente pour Juliette Lemontey. « C’est une façon de ne pas effacer ses erreurs, voire d’amplifier ce qui existe déjà », explique-t-elle. Et quand un résultat ne lui convient pas, elle coupe, découpe, des bouts de toiles pour les recoller sur d’autres œuvres qui évoluent, changent, restent vivantes. Plus que du recyclage, l’artiste y voit une façon d’ajouter « une profondeur dans le temps » sur une toile » et de « donner de la couleur à l’ancien ».
« Comme dans Zabriskie Point… »
« Quand j’étais au lycée, j’observais beaucoup tout ce qui se passait autour de moi. Je n’avais pas d’ambition artistique. Tout est venu petit à petit », se souvient Juliette Lemontey. Représentée par des galeries depuis 2009, elle n’a posé ses bagages à Paris qu’en 2012. En marge des mondanités, petits fours et connivences, elle suit son instinct. Loin des effets de mode, elle revendique des références très personnelles : l’une de ses toiles, réalisée entre deux confinements, représente une danse spontanée au milieu de nulle part, « comme dans Zabriskie Point d’Antonioni ». Puis elle cite Deleuze, Kurosawa, Dostoïevski… Non, elle ne se confine pas avec Netflix. Mais plutôt avec Roland Barthes.

© Celeste Leeuwenburg