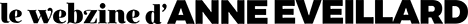Elle aurait dû souffler ses dix bougies en juin 2020. Finalement, ça s’est fait en septembre. Parce que cet été, Paris était désertée : Covid oblige. Ces dix bougies, ce sont celles de la Galerie Gosserez, que Marie-Bérangère Gosserez a créée « alors que je n’y connaissais rien ». Avec le recul, ça la fait marrer. Un rire franc, sincère, qui, selon elle, aurait fait la différence lorsqu’elle était sur les rangs pour acquérir le lieu où sa galerie a élu domicile. Un espace situé dans la partie un peu planquée de la rue Debelleyme, à Paris, à deux pas du resto japonais Ogata.

© Jérôme Galland
« Un tracteur pouvait se retrouver sur la liste des biens à disperser ! »
Elle n’y connaissait « rien », parce que son parcours n’aurait pas dû la conduire, en solo, jusque dans le Marais. Mais elle aime les chemins de traverse. Pas si fréquent pour une fille de juriste, qui a grandi à Epinal et fait son droit à Strasbourg. Sauf qu’en DEA de droit public, « j’ai tenu dix jours ! » Elle bifurque illico en histoire de l’art et intègre la très chic école Christie’s Education. « Le matin, on avait des cours théoriques. L’après-midi, on faisait des visites privées, bien souvent chez des particuliers. » De quoi se forger un goût et se faire un œil. Mais si d’aucuns s’attendaient à la retrouver, ensuite, dans une maison de vente des beaux quartiers, c’est aux Puces, à Saint-Ouen, qu’elle s’installe. Elle a son stand. Sa spécialité : le mobilier vintage, avec un faible aussi pour les céramiques des années 1950. Cette autre « école » lui apprend tout de la véritable valeur marchande des objets. L’aventure, de l'autre côté du périph', dure près de quatre ans. Puis, pour rassurer son père, elle passe l’examen de commissaire-priseur. Ses stages ? Elle les fait chez Tajan et Collin du Bocage. Mais, à Drouot, elle ne retrouve pas le charme des salles de vente de province. Celles où elle allait dans les Vosges. « Celles où un tracteur pouvait se retrouver sur la liste des biens à disperser ! » Elle évoque aussi quelques commissaires-priseurs parisiens capables de changer de cravate en un clin d’œil, « passer d’une rouge à une noire », pour ne pas rater l’enterrement d’un riche client dont ils espèrent récupérer collections, objets, curiosités. Un mode opératoire dans lequel elle ne se reconnaît pas. Alors elle sort du jeu, donne naissance à deux enfants et, parallèlement, se met en quête d’une galerie pour y exposer des designers.

Damien Gernay – banc « Amalgame », L180 x P60 x H40 cm, acier émaillé - © Thierry Depagne
Sa première recrue sortait tout juste de l’Académie des Beaux-Arts de Maastricht

Roxane Lahidji – table d’appoint « Marbled Salts Mountain table » - D70 x H40 cm, sel de mer, gomme végétale, graphite et résine - © Fred Ruyt
« J’ai mis au moins cinq ans à bien positionner la galerie », confie Marie-Bérangère Gosserez. Jamais évident de se démarquer en misant sur des talents inconnus. C’est pourtant cette piste qu'elle va suivre et poursuivre. Un choix radical, qui plaît et fidélise des profils qui refusent le copié-collé, des clients qui ne veulent pas la même déco ni le même décor que les autres. Le parti pris de la galeriste se résume à éviter les stars du design – « d’autres s’en occupent très bien » -, pour défendre des créateurs dont elle aime le travail, le savoir-faire, la personnalité. Sa première recrue ? Valentin Loellmann. « Il sortait tout juste de l’école. » A savoir : l’Académie des Beaux-Arts de Maastricht. Elle l'avait repéré lors de la présentation de son projet de fin de cursus. Depuis, avec lui, la galerie a décroché, à deux reprises, le Prix du design contemporain au PAD London. Parce qu'elle a du nez, la fouineuse. A cela s’ajoute la capacité de Marie-Bérangère Gosserez à pousser la dizaine de designers, qu’elle représente aujourd’hui, vers le sur mesure, la pièce unique, singulière, faite à la main. Idéal pour des clients en quête d’objets « avec une âme et du caractère », dit-elle. Des connaisseurs qui parfois économisent plusieurs mois pour s’offrir une assise ou une table. Comme cette femme qu’Anne-Sophie Lammens, directrice de la galerie, n’oubliera jamais : « C’était ma première vente et cette cliente a pleuré quand elle a vu la petite statue qu’elle avait commandée, posée sur le comptoir, prête à être emballée. » Il y a de l’humain dans tout ça. Et ça fait du bien. Quant à Marie-Bérangère Gosserez, sa séquence « émotion », c’est lorsque l’historienne de l’art, Anne Bony, est venue avec des étudiants de l’Institut français de la mode. « Je ne la connaissais pas physiquement, mais j’avais lu tous ses livres, qui étaient rangés sur une étagère de la galerie. Quand je lui ai demandé son nom, elle a pointé les ouvrages du doigt et m’a dit : tout ça, c’est moi ! » Le quotidien de la galeriste est truffé d’anecdotes, de rencontres, de découvertes. Pas pour elle les esprits étriqués. Il lui faut de la légèreté, un brin de fantaisie et surtout une bonne dose de liberté. D’ailleurs la vie avec un masque, ça ne lui plait pas. Pour en limiter le port, elle vient au boulot à vélo. Une bicyclette turquoise, d’un autre âge, comme celle qu'on retrouve, chaque été, dans un cabanon de maison de vacances, quand on a dix ans.