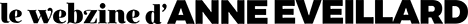Je remercie les grévistes. Surtout ceux de la RATP. Depuis un mois et demi, je circule à vélo. Chaque jour. Avec un même trajet, entre midi et deux. Je roule sur le bitume de quelques rues isolées, loin de tout métro, qui me mènent du boulevard de Port-Royal jusqu’à la place de l’Abbé Georges Hénocque. C’est où ça ? Dans le XIIIe arrondissement. Du côté de la Poterne des Peupliers. Un quartier qui n’a pas de boutiques de fringues ni d’enseignes de luxe, mais encore des maisons. Là, chaque jour donc, je grimpe jusqu’au cinquième étage d'un bâtiment hospitalier dédié à l’oncologie. Dans un service baptisé « soins de suite ». Des soins réservés à celles et ceux qui attendent une chimio, une séance de radiothérapie... Celles et ceux qui se battent contre un cancer, sans savoir s’ils vont y arriver ou pas.
« Regarde sur Google ce qu’il y a dans l’oxycodone ! »
Pousser la porte battante de ce cinquième étage, c’est arriver ailleurs. Dans un monde à part. Un pays où l'on suit l’actu, le nez collé à BFM TV. Alors oui, on sait tout des manifs, des fins de parcours au rythme des canons à eau, de La Rotonde qui n’est plus qu’un tas de cendres… On sait tout, tout en (sur)vivant autrement. Avec les heures de repas, de changement de draps, de la douche, des soins, qui donnent l’impression d’une journée dessinée en suivant des pointillés. A cela s’ajoute des médocs qui assomment, parce que la douleur est insupportable. « Regarde sur Google ce qu’il y a dans l’oxycodone ! » J’ai regardé. C’est un stupéfiant. Un copain de la morphine. Alors d’aucuns délirent un peu, beaucoup, puis parfois pas du tout. D’autres n’ont plus d’appétit. D’autres me disent que demain c’est le réveillon, alors que c’est la Sainte Yvette.
Uniquement des pyjamas…
Je reste là une heure à regarder, écouter, sentir les odeurs de bouffe qui ne donnent pas envie. J’apporte des vêtements de rechange. Uniquement des pyjamas. Parce qu’ici, on ne met que ça. Je change un gant de toilette et un tee-shirt tachés, parce que ce patient a saigné du nez pendant la nuit. Je déplace un étui à lunettes et un téléphone portable un peu plus à droite que d’habitude, parce qu’on a bougé le lit et donc la table de chevet sur roulettes aussi, et le patient, shooté à bloc, a perdu ses repères. Il est même tombé pendant la nuit.
La captivité, ça crée des liens
Corps amaigris, abîmés, flétris, percés par des tuyaux, encombrés par une poche d’urine que d’aucuns trainent comme le boulet des bagnards d’autrefois. Ici, on est ailleurs. Avec des règles différentes de l’extérieur. D’ailleurs de l’extérieur, on n’a que la lumière du jour qui passe par des fenêtres que l’on n’ouvre jamais. L’extérieur ne rentre pas dans cet intérieur, sauf par le biais de quelques visiteurs. Des visiteurs, comme en prison. Car j’observe des amitiés qui se nouent, comme entre codétenus, non pas d’une cellule, mais d’une chambre aménagée pour deux. D’une salle de bains qu’on partage, comme un couple qui vient d’emménager. Pierre et Philippe sont désormais copains. Ils n’ont pourtant rien en commun. Mais la captivité, ça crée des liens. « C’est Pierre qui m’a relevé cette nuit, quand je suis tombé », raconte Philippe. Un bruit court à l’étage qu’on pourrait les séparer, car l’un part faire une radiothérapie pendant trois jours dans un autre établissement. C’est la déprime dans la chambrée.
Il y a de la solidarité dans l’air… chaud
Rien ne m’oblige à y passer tous les jours. Je pourrais prendre des nouvelles de mon père par téléphone ou ne pousser la porte battante de ce cinquième étage qu’une fois par semaine. Mais je crois que je trouve ici une humanité qui se fait rare… dehors. Ici, tout le monde se salue, aide, s’entraide, en attendant les résultats d’une analyse ou d’un scanner. Soignants et soignés forment une équipe. Il y a de la solidarité dans l’air. Un air chaud, car les radiateurs carburent à bloc. Même si pour certains les murs suintent la mort, pour d’autres les bons résultats d’une prise de sang sont pleins d’espoir. A chaque fois que je quitte l’étage, je me demande qui je vais retrouver le lendemain. Car la plupart des portes des chambres restent ouvertes et je vois des lits occupés la veille se libérer soudain le lendemain. Que sont devenus les patients ? Sont-ils rentrés chez eux ? Je ne sais pas. Je ne demande pas.
Garder le moral en passant rue de l’Espérance
Je remercie les grévistes, donc. Car revenir de la place de l’Abbé Georges Hénocque à vélo me sert de sas de décompression. Ce trajet d’un quart d’heure permet d’être fouettée par le courant d’air propre à la rue de la Colonie, garder le moral en passant rue de l’Espérance, reprendre son souffle rue Daviel et revenir à la réalité rue de la Glacière, en changeant de vitesse pour dépasser le bus 21 archi bondé. Ça y est ! Je suis arrivée. Jusqu’au prochain trajet. Jusqu’à la prochaine ascension au cinquième étage.