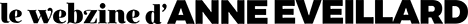« Vous sonnez et vous tirez la porte du transfo… » Pas banal. Sa porte d’entrée est celle d’un transformateur électrique. Il est comme ça, le photographe Jean Larivière : chez lui, la quête de l’insolite démarre dès l’interphone. Ensuite, une fois dans sa maison, on navigue entre pays de cocagne et pays des merveilles. Objets, images, dessins, magazines, tirages grands formats, collections de jouets, de mouches… tout attire l’œil. Tout raconte une histoire. La sienne démarre à Angers, place de la Visitation, qu’il a connue sous les bombes durant la seconde guerre mondiale. Enfant de chœur à l’église Saint-Joseph, il aime déjà dessiner. Si bien qu’après le lycée, il intègre les Beaux-Arts d’Angers. La suite : un service militaire en Algérie. Puis, son arrivée à Paris, pour voir, savoir, sentir, ressentir, apprivoiser ce nouvel espace de liberté. « Je voulais faire de l’art avec un appareil photo. Ce qui ne voulait pas forcément dire qu’on allait être photographe ». D’ailleurs, à ses débuts, sous l’influence du réalisateur Chris Marker, il flirte avec le cinéma d’animation : on lui doit notamment le film Jamais toujours, une curiosité qui a nécessité dix ans de travail, où il se focalise sur une balle de golf. En voyant ce film, le peintre surréaliste Roberto Matta va comparer Larivière à Marcel Duchamp. Nous sommes à l’orée des années 1970. Epoque où il suffit parfois de croiser une star dans un bistrot pour bosser avec elle le lendemain. Larivière, lui, appelle Dali au Meurice, sans le connaître : « vous êtes à Paris ? Vous avez de la chance, moi aussi. Voyons-nous… » L’audace de l’inconnu séduit Dali. Il lui donne rendez-vous. Larivière lui montre alors une drôle de « machine à désintégrer les sentiments érotiques ». Dali adore. Il en commande une version en matériaux précieux. Mais, faute de moyens, le projet ne verra pas le jour.
« Vous sonnez et vous tirez la porte du transfo… » Pas banal. Sa porte d’entrée est celle d’un transformateur électrique. Il est comme ça, le photographe Jean Larivière : chez lui, la quête de l’insolite démarre dès l’interphone. Ensuite, une fois dans sa maison, on navigue entre pays de cocagne et pays des merveilles. Objets, images, dessins, magazines, tirages grands formats, collections de jouets, de mouches… tout attire l’œil. Tout raconte une histoire. La sienne démarre à Angers, place de la Visitation, qu’il a connue sous les bombes durant la seconde guerre mondiale. Enfant de chœur à l’église Saint-Joseph, il aime déjà dessiner. Si bien qu’après le lycée, il intègre les Beaux-Arts d’Angers. La suite : un service militaire en Algérie. Puis, son arrivée à Paris, pour voir, savoir, sentir, ressentir, apprivoiser ce nouvel espace de liberté. « Je voulais faire de l’art avec un appareil photo. Ce qui ne voulait pas forcément dire qu’on allait être photographe ». D’ailleurs, à ses débuts, sous l’influence du réalisateur Chris Marker, il flirte avec le cinéma d’animation : on lui doit notamment le film Jamais toujours, une curiosité qui a nécessité dix ans de travail, où il se focalise sur une balle de golf. En voyant ce film, le peintre surréaliste Roberto Matta va comparer Larivière à Marcel Duchamp. Nous sommes à l’orée des années 1970. Epoque où il suffit parfois de croiser une star dans un bistrot pour bosser avec elle le lendemain. Larivière, lui, appelle Dali au Meurice, sans le connaître : « vous êtes à Paris ? Vous avez de la chance, moi aussi. Voyons-nous… » L’audace de l’inconnu séduit Dali. Il lui donne rendez-vous. Larivière lui montre alors une drôle de « machine à désintégrer les sentiments érotiques ». Dali adore. Il en commande une version en matériaux précieux. Mais, faute de moyens, le projet ne verra pas le jour.
« Je sais faire des photos nettes »
« Le hasard et les rencontres ont rythmé mon parcours », confie le photographe. On le sent sensible aux signes que la vie peut faire. A la fin des années 1970, il hésite entre l’opportunité de travailler pour la maison Louis Vuitton, au patron de laquelle il a juste dit qu’il savait faire « des photos nettes », et celle de suivre le réalisateur François Reichenbach qui prépare un film sur Jacques-Henri Lartigue. « Je suis à Montréal avec une amie photographe. Je lui explique que j’ai du mal à me décider. Nous sommes dans un taxi. Et là, je demande au chauffeur de s’arrêter et à cette amie de me prendre en photo devant l’intersection de l’avenue Lartigue et de la rue Larivière… » « Votre rencontre est faite désormais, entre Lartigue et toi. C’est donc pour Louis Vuitton que tu dois travailler », m’a dit mon amie. C’est comme ça que Larivière démarre sa collaboration avec le célèbre malletier. Une complicité qui l’a mené dans une vingtaine de pays et qui dure encore. La photo officielle de la Fondation Louis Vuitton, c’est lui. Mais ce serait injuste de ne résumer le travail de l’artiste qu’à ses campagnes de pub. Le plus fascinant chez Larivière, c’est son côté explorateur. Par exemple, quand il embarque à bord de la Jeanne d’Arc pour « photographier le vent ». La poésie est omniprésente dans ses images, qu’il dessine bien souvent avant de les réaliser. Alors qu’il peaufine actuellement une monographie, il cherche aussi le bon endroit pour exposer ses trésors. A commencer par la machine dont Dali rêvait. Mais aussi une série de portraits où se croisent Andrée Putman, des « pieds marins », un polichinelle… En refermant la porte du transfo, le retour à la réalité est brutal. L’atterrissage forcé. On aurait bien plané encore un peu avec le créateur du kit « Comment devenir Jean Larivière ». Un coffret qui avait beaucoup plu à Max Ernst.