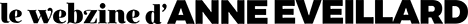Il faut des situations de crise pour que certains se révèlent sous un jour nouveau. Je viens d’assister au départ de 90% des membres d’une rédaction de magazine, suite à l’ouverture d’une clause de cession. Durant un mois, des gens qui ne se parlaient pas, ont échangé infos, points de vue, bu un café ensemble, déjeuné à la même table. Fini l’indifférence, les regards fuyants, les yeux rivés sur l’iPhone jusque dans l’ascenseur pour éviter de dire « bonjour ». Subitement, on se salue, on se sourit, on se tient la porte… des toilettes. La machine à café sert de QG le temps d’un « choco-lait » : époque formid’ ! Quand l’une obtient une info, elle la partage. Quand l’autre décroche un scoop en provenance des syndicats, les SMS fusent. Question : pourquoi cette connivence n’est-elle pas une évidence, d’emblée, quand on intègre une entreprise ? Pourquoi faut-il être au bord du précipice pour voir et s’apercevoir que son voisin de bureau n’est pas si borné, sa voisine pas si insensible ? Et puis, le dernier jour arrive. On quitte le journal comme on franchit le seuil de son lycée, sa collante de bac dans la poche, en se disant que plus jamais on ne fera le chemin inverse. « On ne se perd pas de vue, hein ? » On a tous dit ça à ses meilleurs copains de classe et finalement on n’en revoit pas des masses. L’implosion d’une rédaction, c’est assez proche de ça. Une sorte de fin de colo. On s’est fritté, engueulé, réconcilié, rapproché, mais trop tard, l’arbitre a sifflé la fin de partie. D’aucuns retrouvent un job ailleurs. Et quelques-uns se disent qu’il serait bien, enfin, d’oser marcher en dehors des clous. Comme ça, pour voir. Même si, comme l'écrit l’ami Régis Descott dans son roman Souviens-toi de m’oublier (Le Livre de poche) : « Après avoir dirigé deux ministères, il était sans poste, et considéré comme d’autant plus dangereux »…
Il faut des situations de crise pour que certains se révèlent sous un jour nouveau. Je viens d’assister au départ de 90% des membres d’une rédaction de magazine, suite à l’ouverture d’une clause de cession. Durant un mois, des gens qui ne se parlaient pas, ont échangé infos, points de vue, bu un café ensemble, déjeuné à la même table. Fini l’indifférence, les regards fuyants, les yeux rivés sur l’iPhone jusque dans l’ascenseur pour éviter de dire « bonjour ». Subitement, on se salue, on se sourit, on se tient la porte… des toilettes. La machine à café sert de QG le temps d’un « choco-lait » : époque formid’ ! Quand l’une obtient une info, elle la partage. Quand l’autre décroche un scoop en provenance des syndicats, les SMS fusent. Question : pourquoi cette connivence n’est-elle pas une évidence, d’emblée, quand on intègre une entreprise ? Pourquoi faut-il être au bord du précipice pour voir et s’apercevoir que son voisin de bureau n’est pas si borné, sa voisine pas si insensible ? Et puis, le dernier jour arrive. On quitte le journal comme on franchit le seuil de son lycée, sa collante de bac dans la poche, en se disant que plus jamais on ne fera le chemin inverse. « On ne se perd pas de vue, hein ? » On a tous dit ça à ses meilleurs copains de classe et finalement on n’en revoit pas des masses. L’implosion d’une rédaction, c’est assez proche de ça. Une sorte de fin de colo. On s’est fritté, engueulé, réconcilié, rapproché, mais trop tard, l’arbitre a sifflé la fin de partie. D’aucuns retrouvent un job ailleurs. Et quelques-uns se disent qu’il serait bien, enfin, d’oser marcher en dehors des clous. Comme ça, pour voir. Même si, comme l'écrit l’ami Régis Descott dans son roman Souviens-toi de m’oublier (Le Livre de poche) : « Après avoir dirigé deux ministères, il était sans poste, et considéré comme d’autant plus dangereux »…