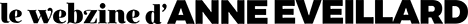« Quand j’étais petite, je mentais beaucoup. J’inventais. Même à propos de ce que j’avais mangé à midi. C’était ma façon de raconter des histoires. Si bien que, très vite, j’ai su que je voulais devenir écrivain… Aujourd’hui, je ne mens plus ». A 15 ans, Amanda Sthers envoie un premier manuscrit à l’éditeur Jean-Marc Roberts. Il ne la publie pas, mais l’encourage à persévérer. Notamment dans l’écriture pour la télé ou le cinéma, « car vous avez un sens du dialogue ». « Après avoir lu sa lettre, j’ai couru à la Fnac des Ternes pour acheter un livre qui expliquait comment bâtir un scénario », se souvient-elle. Douée ou peut-être plus mature que les autres, ses parents lui font sauter une classe. « J’avais déjà un an d’avance ». Résultat : elle décroche son bac littéraire à 16 ans, « en étant nulle en maths ». Inscrite en hypokhâgne à Louis-le-Grand -« pour faire plaisir à mes parents »-, elle sèche les cours. Pour écrire et soumettre sa plume au regard des autres. « Tant que je n’étais pas publiée, je n’étais pas écrivain. C’était une douleur ».
« Quand j’étais petite, je mentais beaucoup. J’inventais. Même à propos de ce que j’avais mangé à midi. C’était ma façon de raconter des histoires. Si bien que, très vite, j’ai su que je voulais devenir écrivain… Aujourd’hui, je ne mens plus ». A 15 ans, Amanda Sthers envoie un premier manuscrit à l’éditeur Jean-Marc Roberts. Il ne la publie pas, mais l’encourage à persévérer. Notamment dans l’écriture pour la télé ou le cinéma, « car vous avez un sens du dialogue ». « Après avoir lu sa lettre, j’ai couru à la Fnac des Ternes pour acheter un livre qui expliquait comment bâtir un scénario », se souvient-elle. Douée ou peut-être plus mature que les autres, ses parents lui font sauter une classe. « J’avais déjà un an d’avance ». Résultat : elle décroche son bac littéraire à 16 ans, « en étant nulle en maths ». Inscrite en hypokhâgne à Louis-le-Grand -« pour faire plaisir à mes parents »-, elle sèche les cours. Pour écrire et soumettre sa plume au regard des autres. « Tant que je n’étais pas publiée, je n’étais pas écrivain. C’était une douleur ».
Son argent de poche disparaît chez Copy-Top
Elle enchaîne concours de scénarios, bourse d’études à New York -« j’étais serveuse et DJ pour vivre »-, rédaction d’épisodes pour la série Caméra Café, écriture de romans et « plein de lettres de refus ». Elle a 20 ans. Le plus bel âge ? C’est celui de la vie en solo : « dans mon premier appart’ ». Celui des petits boulots d’hôtesse, de vendeuse : « je comprends que, plus tard, je ferai tout pour ne pas rendre de comptes à des idiots ». L’âge aussi où son argent de poche disparaît chez Copy-Top, son QG pour imprimer ses manuscrits. Puis, elle croise la route du critique littéraire Pierre Canavaggio : « il dissèque l’un de mes textes, me le fait retravailler, m’ouvre sa bibliothèque et je me mets à avoir un regard ».
« Si je ne suis pas publiée à 25 ans, je me tue »
« A l’époque, je me disais : si je ne suis pas publiée à 25 ans, je me tue ». Elle l’est à 26. Avec Ma place sur la photo (Grasset). « Ce livre ne me ressemble pas, dit-elle. Et ce, dès la première page, où l’on a remplacé le verbe chialer par pleurer ». Or, pour elle, écrire n’est pas trahir. C’est « mettre en avant ses bizarreries, montrer ce que l’on a de douloureux ». Ce qu’elle réitère, en 2006, avec la pièce Le Vieux Juif blonde - « un ovni, une étrangeté »-, depuis étudiée à Harvard : époque formidable. Le soir de la première au Théâtre des Mathurins, alors que tout le gratin de la presse occupe les rangées VIP, elle se réfugie en coulisses et boit du whisky avec Jacques Weber, metteur en scène de son texte. « C’est là que j’ai su que je devais faire ce métier d’écrivain. J’en avais enfin le droit ». Une sorte de reconnaissance. Autre que celle d’être la première épouse de Patrick Bruel ou la compagne de Sinclair. Car la presse people l’observe. De près quand elle écrit la bio de Johnny Hallyday. De loin lorsqu’elle s’échappe dans sa maison de campagne, dans l’Yonne. De près quand Vanity Fair la propulse « écrivain la plus sexy du monde ». De loin lorsqu’elle noircit ses carnets Moleskine, achetés à L’Ecume des pages. « On met beaucoup de temps à ressembler à ce que l’on est à l’intérieur », souligne-t-elle encore. Et ce d’autant qu’à chaque nouveau livre qu’elle amorce, « c’est comme si je repartais à zéro ».